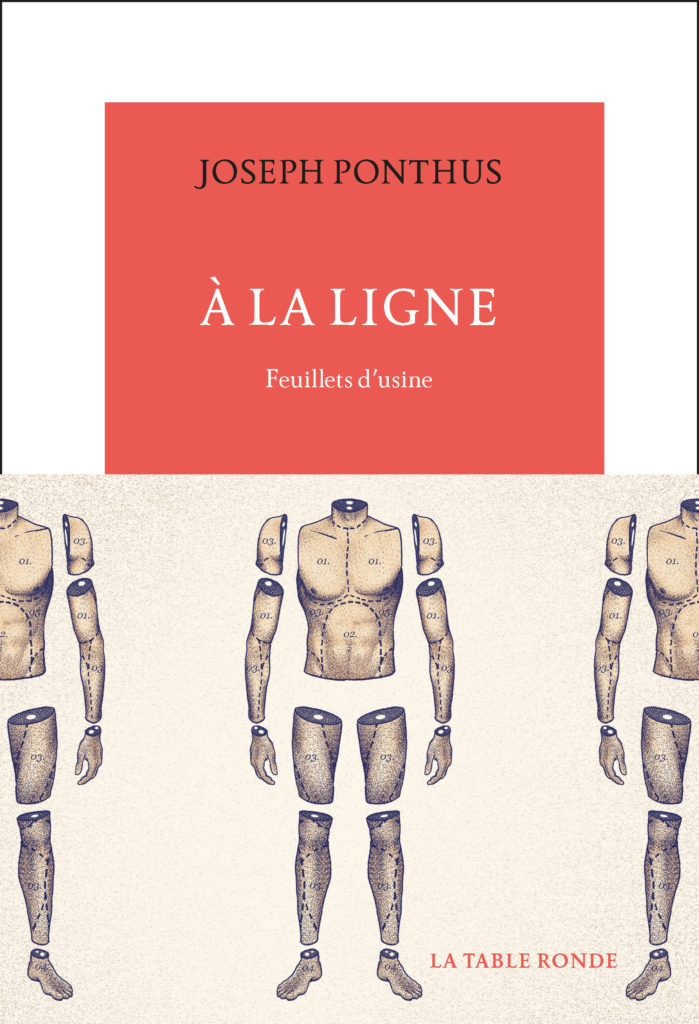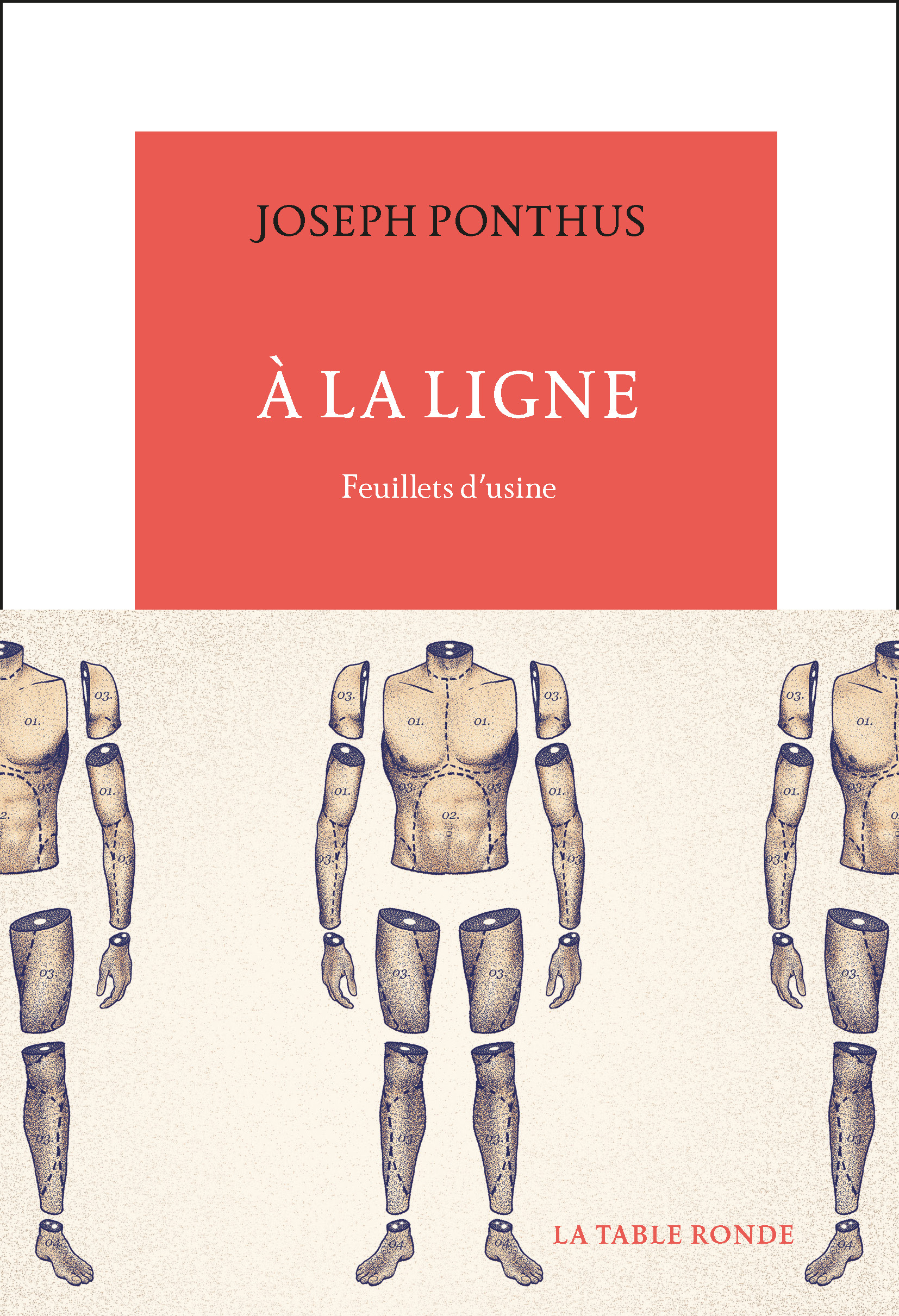Récit autobiographique, l’auteur raconte comment un « intellectuel » (c’est lui qui le dit) a été catapulté du jour au lendemain dans une usine par une agence intérim. Éducateur social à la base, il s’installe en Bretagne pour rejoindre son épouse. Il ne trouve pas de poste correspondant à son profil et il va donc voir une agence de travail temporaire.
L’ouvrage vaut pour son témoignage : la vie quotidienne de l’ouvrier d’aujourd’hui, que l’on tente d’invisibiliser pour ne pas confronter l’opinion publique à l’horreur. La pub montre des éleveurs bienveillants en chemise à carreaux et béret sur la tête, d’heureux poulets qui courent dans un grand pré. L’ouvrage de Joseph Ponthus nous montre ici l’envers du décor : une usine gigantesque qui tue, découpe et emballe à une cadence infernale.
L’auteur a traduit ce rythme staccato par des vers libres sans ponctuation et uniquement avec des retours à la ligne. Ça ne s’arrête jamais et l’on est quasiment obligé de tourner les pages. Le chapitres sont courts et nombreux. Chacun représente une journée : la description du travail, les pensées qui vont avec, les horreurs vues et entendues, les réflexions personnelles, les marques de solidarité ou de rancœur avec les collègues.
Du fait de son travail basique de manutention, l’ouvrier est balloté d’une filière à l’autre : les crevettes, les poissons, les bulots. On atteint un autre niveau quand on passe aux abattoirs avec son lot de boyaux, de sang, de merde et d’organes internes à trier.
L’auteur y détaille un inventaire des souffrances : le mal de dos, dans les mains et les bras, la dépression qui le guette, la cadence qui rend fou, le risque d’amputation lié aux machines dangereuses, le travail de nuit, les convocations à la dernière minute ou pendant les fêtes. La liste est longue.
Il y a aussi les éléments de langage qui participent au masquage de la pénibilité. Ainsi on ne parle plus d’une chaîne de production mais d’une ligne de production.
Mais si l’on a bien compris que l’usine est inhumaine, on n’y trouve guère de critique. On devine une fatalité : c’est comme ça et puis tant pis. Yen a qui en chient. Il est dit aussi que les études et la culture de Joseph Ponthus l’ont sauvé de la folie.
En convoquant de nombreux auteurs (Apollinaire, Dumas, Perec, Trenet et d’autres), l’auteur trouve son salut. Le travail manuel et physique, source de souffrances, est atténué par les pensées et les souvenirs. Il trouve un écho entre ce qu’il vit et ce qu’il a lu. L’intello serait donc le candidat idéal pour travailler à l’abattoir ?
Cette vision me paraît un peu étrange car elle tend à voir du beau là où il n’y a que souffrance et domination. Elle ne s’enquiert pas non plus de connaître le sort de ceux qui n’ont pas la culture nécessaire « pour s’en sortir ». Ayant envoyé un exemplaire de l’ouvrage à un dirigeant de l’abattoir, « son contrat n’est pas renouvelé » et il se retrouve au chômage. Mais que deviennent les titulaires ou ceux qui pratiquent l’intérim à durée indéterminée ?
De même, il n’y a pas de remise en cause du système. Aucune question ou presque ne se pose vis-à-vis de nos modes de consommation. L’industrie agro-alimentaire répond avant tout à un besoin qui nous concerne tous. Mais dans A la ligne, non. On est contents de pouvoir aller manger de l’onglet premium à la cantine pour un prix dérisoire, participant ainsi symboliquement à la perpétuation du système.
Editeur : La Table Ronde.