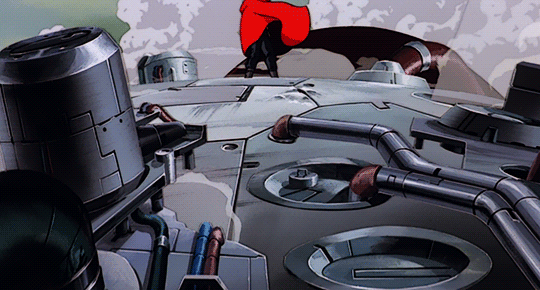Résumé de l’épisode précédent : soit le monde prend fin et c’est bien fait pour sa gueule ; soit la fin ne se profile, mais alors pas du tout, et c’est bien ça l’ennui.
Un savant (aux normes punks vs. skins) mélange des deux : Green Room
On nous promet du punk écervelé et du skin décérébré. Le tout dans une boule à neige lacrymo. Baignant dans son odeur caractéristique de sueur mêlée de Cuvée des Trolls (sponsor officiel du BIFFF), le « grand amphi » du Bozar transpire l’impatience. Débarque à l’écran un groupe de punks gentillets, niais et désargentés, en goguette dans leur van pourri. Une longue introduction sur le motif de la route. Les lacis du bitume au fenêtre, la vitesse molle à l’aune des arbres, qui forment une barre jaunie dans le reflet des visages. Des contre-jours posant leur hésitation blanche sur les trognes des mignons punkounets, en mode « gueule de bois permanente ». Les musicos parlent peu, se regardent à peine. Ça sent la fin de tournée, façon équipage à bout de jus du Nostromo d’Alien. Une lassitude mâtinée ici d’une énergie de chiot embêté par un collier trop serré : le punk est-il rebelle donc fauché ? Ou parce que fauché ? Les motivations de chacun sont floues. On critique les goûts musicaux des camarades pas si punks, ou trop punks. On se déclare anti-système, mais on grogne de jouer au chapeau dans un diner à burgers. Toute la blague de l’action politique d’aujourd’hui, fatalement teintée de désenchantement, grevée de dissensions, et forcée de composée. Bassque finalement, ils vont jouer chez les Skins pour bouffer.
On est des punks, bordel, quoi, c’est trop cool ! (Callum Turner, Alia Shawkat et Anton Yelchin dans Green Room)
À cette fatigue joliment Instagram de beat generation virtuellement augmentée (le smartphone de la punkette sera, concrètement, le pivot autour duquel basculera l’intrigue) vient s’incruster la seconde partie du récit, parfaitement inverse à la première : à la liberté oxygénée de l’errance brouillon, en groupe, s’oppose l’enfermement, l’organisation productiviste, la segmentation. L’extérieur, le sépia, le panoramique coagulent en un miasme confiné, vert d’eau, étroit. Introducing… LES SKINS ! Tout est en place, semble-t-il, pour la battle promise. Mais non. Il faudra attendre encore. Comme un vrai bon film d’assaut inversé. Ici, nul loup dans la bergerie, mais des moutons trop cons dans la louverie, et un apprenti méchant besogneux aux allures de Michel Blanc (Macon Blair, excellent). We Should Split Up suggère intelligemment un des punks. S’en suit une série de petits guet-apens. Où chacun fait tour à tour preuve d’ingéniosité et de bêtise. Des recommencements scandés de parfaite hébétude. Une composition pour orchestre de guérilla urbaine, parfaitement renseignée sur les conflits de basse intensité. Car Green Room libère joyeusement – mais savamment – le cinoche américain d’un de ses topos militaires les plus tenaces. L’ingéniosité individuelle du GI ne prime pas sur la machine aveugle, broyant l’humain, d’un Nième avatar de l’ennemi nazi ou soviétique. La motivation idéologique du méchant ne lui donne pas non plus l’avantage. On est, avec Green Room, au plus près de la tactique, avec son lot de gâchis, de chance et d’acharnement. Pas toujours récompensé.
Ouais, mais vous tirez comme des pieds (Imogen Poots, dans Green Room)
Ah oui : et vous verrez le Captain Picard en Barbour. Bizarre.
La solution ? Exterminer TOUTES les saucisses nazies anales (non, ce n’est pas une coquille)
Contrepoint absolu du métrage précédent, Yoga Hosers est une tranche de Nazisploitation bon enfant et déjantée, dégoulinante de sirop d’érable (et de choucroute), offerte par Kevin Smith en guise de « suite » au mémorable Tusk. L’homme de Clerks (I, II, III) aime filer ses métaphores et palper ses univers. Avec Yoga Hosers, ce boulimique du running gag prouve encore une fois qu’il est inextinguible, à l’image de ses deux héroïnes, Colleen McKenzie (Harley Quinn Smith, sa propre fille) et Colleen Colette (Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp). J.D. himself, ancien clown blanc récemment promu contre-pitre, reprend son personnage de détective québécois à l’hygiène douteuse : le méconnaissablement moche Guy Lapointe.
Colleen McKenzie (Harley Quinn Smith) et Colleen Colette (Lily Rose Depp) s’éclatent dans Yoga Hosers.
En résulte un OVNI chamarré et volubile, reposant sur la substantifique moelle d’une adolescence blasée, foutraque et charnelle, incarnée par le duo Harley Quinn Smith – Lily Rose Depp, qui n’ont pas l’air de se forcer pour déblatérer les dialogues sous amphèt’ d’un Kevin Smith très en forme. Vous y verrez des saucisses nazies proctologues proférer « Wunderbar ! » d’une voix de lutin castré, un SS imiter l’accent de Schwarzy, un yoga appliqué à l’art de la guerre en superette et surtout, deux adolescentes éviscérant avec une joie non dissimulée le carcan imposé par les adultes. Car c’est là où Kevin Smith se pose en véritable trublion. Il ne donne pas, comme font trop de cinéastes, sa version nostalgique d’une adolescence made in 90es, vaguement adaptée aux nouvelles technologies. Il embrasse le contemporain, lui tend un porte-voix. Outre son portenawak jouissif, c’est cette complicité, cette liberté, cette tendresse qui donnent un ton inédit à ce métrage rafraîchissant, dépourvu de jeunisme. Ah oui, et il y a un gros monstre à la fin.
Finalement, mourir, c’est pas si pire
Bon, c’est bien beau, la fin du monde, les boucles, les bastons avec du Nazi dedans… mais les fantômes ? Et bien les fantômes se portaient très bien au BIFFF 2016 merci.
Hop, je vous propose ceci en guise de BO de ce qui suit :
Les fantômes sont pépères. Autant la SF, depuis Inception, est attendue à chaque tournant (« Quoi, un vaisseau spatial ? Quoi, une épidémie ? Il faut que ce soit ORIGINAL ! Un truc tordu qu’on n’a jamais vu, tu saisis ? »), la sauce gothique persiste à nous parler des morts subies et de notre agonie à venir. Ça suit son petit fil noir d’araignée. Et je trouve ça bien. On continue de sursauter devant son miroir, dans sa douche, enfermé dans un placard, derrière la vitre. Le train fantôme roule. J’ai donc regardé avec un plaisir sans surprise le Backtrack appliqué de Michael Petroni. Un chemin de fer classique et cinéphile , posé, paraissant la version colorisée et restaurée d’un classique de l’âge d’or du spectre britannique et de son pendant américain, façon Jack Clayton et ses Innocents, Robert Wise et sa Maison du Diable. Rien de neuf sous le soleil, mais ça se mange sans faim. Gros plans sur les visages, les objets, le nez d’Adrien Brody torturé (il a l’air de bouffer Casper chaque fois qu’il déglutit son whisky). Extirpation psychanalytique d’une vérité affreuse, enfants muets flippants, ne jamais remettre à demain son examen de conscience, tout ça… Il est des restos dans lesquels on commande systématiquement le même plat. Moi, j’aime les films de fantômes. Mais si vous cherchez la nouveauté, passez votre chemin !
— Il y a combien de gouttes sur la vitre, tu crois ?
— Euh, 26 ? 37 et demi ? JE SAIS PAS !
(Adrien Brody et Chloe Bayliss dans Backtrack)
La trame du court finlandais Tuolla puolen (Reunion en anglais), de Iddo Soskolne et Janne Reinikainen, est également très classique : une adolescente morte dans les années 1980 continue de veiller sur son entourage et accueille dans la mort chaque nouveau défunt. Le métrage se distingue néanmoins par son humour noir et son traitement à la fois réaliste et onirique, à la Kaurismäki. L’image, parfaitement synchronisée à la voix off, donne l’impression d’une longue incantation scandée de chamane frappé de synesthésie. Le deuil recouvre la petite communauté de banlieue d’un drap tantôt étincelant, tantôt nuit noire. L’ombre des arbres se projette sur les barres d’immeubles blanches, comme la main d’une faucheuse délicate. Il ne s’agit donc pas ici de terreur, mais bien d’humanisme.
Voilà ! Mangez du cinoche ! Merci le BIFFF !
Et donc, ces longs métrages ?
Par ordre de préférence, ça donne ça :
Southbound, de Radio Silence, Roxanne Benjamin, David Bruckner et Patrick Horvarth
Grand Huit essoufflé, gore et dépressif, dans le désert californien dans le désert californien dans le désert californien dans le désert californien dans le désert californien.
Yoga Hosers, de Kevin Smith
Délire Buffygore jouissif, régressif, et étonnamment contemporain dans sa nostalgie.
Green Room, de Jeremy Saulnier
Kill ‘em all enraillé en trois temps. Petit bijou de rythme(s) et de rupture(s).
Into the Forest, de Patricia Rozema
Première partie crépusculaire : variation incarnée, immersive et maîtrisée sur le thème de l’agonie. Deuxième partie en mode Survival, moins convaincante en termes d’écriture, mais très belle énergie du duo d’actrices.
Backtrack, de Michael Petroni
Classique gothique maniériste. Pour les amateurs de lumières dorées, de l’Australie, des fantômes de Crimson Peak et du nez d’Adrien Brody devant.